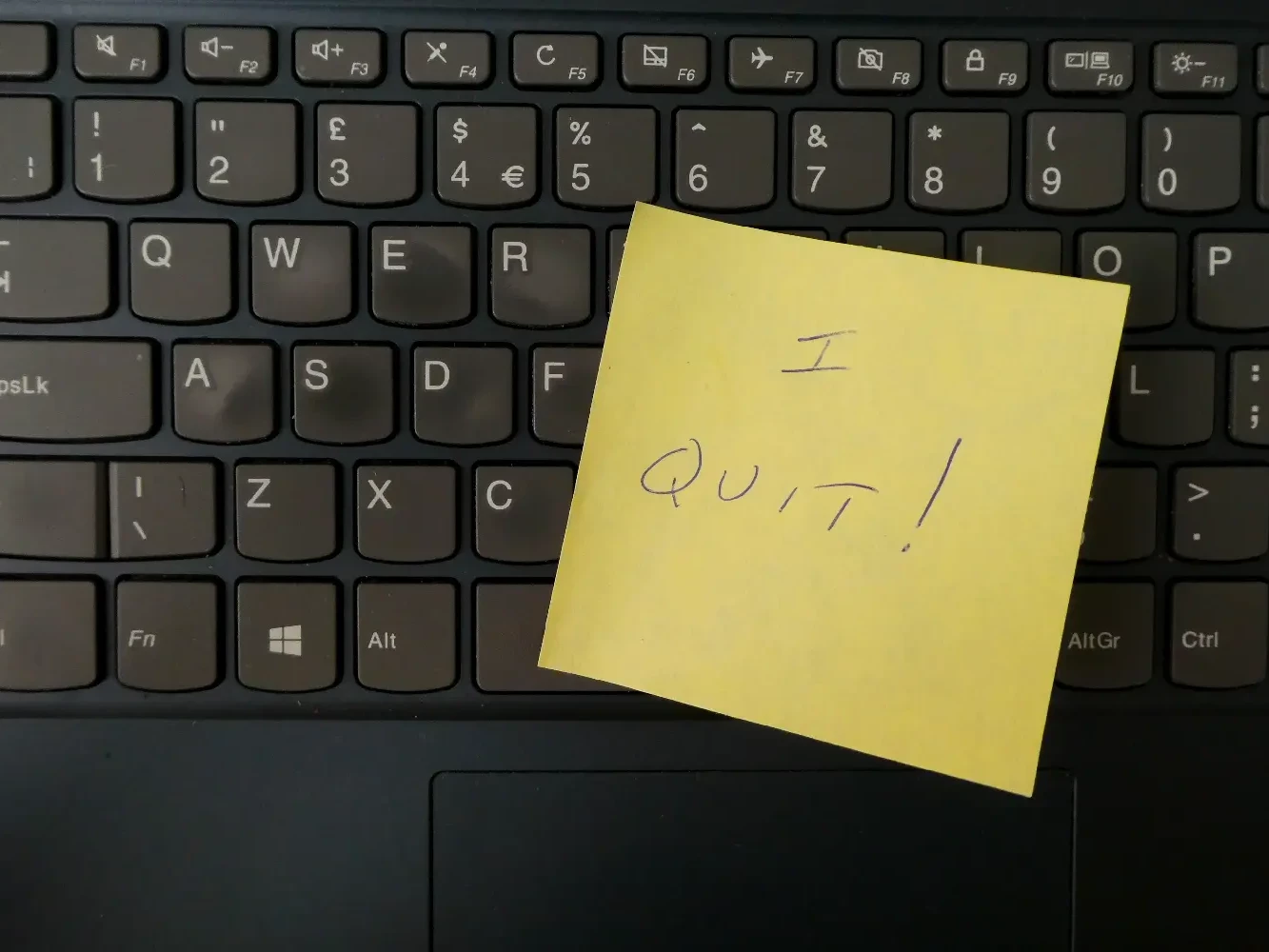Mon invité est Philippe Peusch-Lestrade, ancien associé du cabinet Ernst and Young, administrateur de PlaNet Finance et du Téléthon. Le sujet de l’émission est le suivant : « Le fait de travailler dans le social business représente-il une réponse à une perte de sens rencontrée dans les entreprises par les salariés aujourd’hui ? » Le social Business apparaît souvent comme une réponse face à des entreprises, qui ont tendance, selon certains, à faire fi de l’humain.
Mireille Garolla : Philippe Peuch-Lestrade bonjour. Vous avez fait un passage très intéressant des entreprises très capitalistes vers des entreprises plus axées vers le Social Business. Vous avez travaillé ainsi dans des deux univers professionnels très différents et vous êtes à même d’aider nos auditeurs qui cherchent une nouvelle orientation professionnelle.
De plus en plus de personnes sont intéressées par l’économie sociale et solidaire. Je voudrais que vous nous aidiez à analyser ou à décortiquer ce mythe, pour que les gens qui décident de s’engager dans cette voie, le fassent par un choix de vie réfléchi plutôt que par la fuite d’un système plus capitaliste. De manière assez simple, l’Economie Sociale et Solidaire qu’est-ce que c’est ? Depuis combien de temps ce secteur est-il apparu et quelles sont les différents éléments qu’il recouvre ?
Philippe Peuch-Lestrade : L’Economie Sociale et Solidaire, c’est concilier activité économique et utilité sociale. Le point de départ est que la globalisation marchande a montré ces limites avec les crises de 2007-2009. Et le besoin pour chacun de s’éloigner du contexte de la logique de marché avec des objectifs financier à court terme est apparu. Face à cela, ce que les gens recherchent, c’est la logique du don. Les gens veulent donner leur compétence à la société. Ils veulent retrouver dans l’échange un enrichissement personnel. C’est la base de ce rapport social qui fonde l’Economie Sociale et Solidaire. Pourquoi les gens se mobilisent sur une nouvelle dimension ? Parce que les économistes et les statisticiens qui servent les gouvernements ont toujours un train de retard. Et aujourd’hui, les statisticiens d’Eurostat veulent même intégrer dans le PIB les revenus nés de la drogue et de la prostitution ! L’univers institutionnel a perdu du sens. Il est légitime de vouloir y remettre du sens. Pour conclure, les gens qui s’engagent veulent remplacer la société du bien par la société du lien. Ils veulent bien vivre en collectivité.
MG : Qu’est ce qui fait sa « marque de fabrique » et le fait que l’on puisse dire qu’une société, une organisation ou une association en fait partie ou pas ?
PPL : Il y a plusieurs définitions. Mais c’est un univers très vaste. L’ESS, c’est 10% du PIB, c’est 12% des emplois du privé, 230 000 entreprises qui emploient 2,3 millions de salariés. En terme de rémunération, c’est 56 milliards d’euros versés. C’est une part très forte. C’est un univers très dynamique car c’est là qu’il y a une plus grande croissance d’emploi. Selon le gouvernement, on a + 24 % en 13 ans. Hors ESS, la moyenne réalisée représente le cinquième dans le secteur marchand. Cet écart est considérable.
La marque de fabrique est aussi dans la loi sortie récemment. Autour de 4 principes : Premièrement, la Liberté d’adhésion (on est très libre d’entrer et de sortir), une gestion collective (1 homme = 1 voix quel que soit le capital), une lucrativité limitée ou absente, des fonds propres impartageables. Il s’agit de société de personnes et non de capitaux. La loi a aussi fixé 5 objectifs. Le premier est de reconnaitre l’économie solidaire et sociale comme un mode d’entreprise spécifique ; de consolider un réseau existant, renforcer sa gouvernance et les circuits de financements de l’ESS ; de donner du pouvoir d’agir au salariés ; de provoquer un choc coopératif ; et de renforcer la politique de développement local durable. Ainsi instrumentalisé par loi, l’ESS dérape un peu. Car ces principes sont aussi dans l’économie marchande. Les limites entre économie marchande et économie solidaire et sociale ne sont plus si claires. Les marques de fabriques de ces deux économies s’estompent.
MG : Certains ont parfois des idées préconçues. Et on entend, par exemple, que le domaine de l’ESS est un secteur moins concurrentiel et moins complexe que l’économie capitaliste, qu’en pensez-vous ?
PPL : L’ESS regroupe des 4 différentes composantes : les coopératives (principalement le secteur bancaire et la distribution agricole), les mutuelles (domaine de l’assurance), les associations et les fondations. Sur 2,3 millions de personnes salariés, 1,8 sont dans les associations (le plus grand nombre). Il y a des milliers d’associations. C’est donc très concurrentiel. Les coopératives et les mutuelles qui représentent le plus grand poids économique sont en plus en pleine concurrence avec les acteurs traditionnels. La MAIF ou le Crédit Agricole sont en concurrence avec les géants du secteur.
MG : Quelles sont les problématiques spécifiques au fait de travailler dans ce secteur ?
PPL : La première caractéristique intrinsèque concerne le taux de présence des femmes. Elles représentent 67% du secteur de l’ESS. C’est plus que dans le secteur privé (40%) et dans le public (60%). Les taux de cadre sont supérieurs à ceux du public et du privé. Ils représentent 15% des emplois. Enfin, l’emploi à temps partiel est plus important que dans le secteur privé et public surtout si on retraite les mutuelles et les coopératives. Autre marque, ce secteur devrait embaucher, selon le gouvernement, 600 000 emplois d’ici 2020 notamment grâce au renouvellement de la pyramides des compétences. Les salariés de l’ESS sont plus âgés que dans le secteur concurrentiel.
MG : Quels sont les critères essentiels pour s’intégrer dans ce secteur ?
PPL : Dans le secteur d’activité financière et d’assurance ou dans une mutuelle, il n’y a pas de différences. Mais dans les associations, il y a une différence. Les associations interviennent dans l’action sociale. Il faut être à l’aise avec un univers paupérisé et vieillissant. Il faut un certain mental et un physique résistant. En parallèle, Il faut renoncer à un niveau de salaire moyen. L’ESS représente 10 % des salariés mais 8% des rémunérations. Il y a donc une réduction de rémunération de 20- 25% sur tous types de postes mais surtout au niveau des cadres et des classes moyennes. Les classes moyennes sont ceux qui ont à souffrir de leur engagement militant. Enfin, ce secteur offre moins de possibilité d’évolutions de carrières que dans des grands groupes internationaux. En bref, il faut un profil psychologique et physiologique, une acceptation concernant une baisse de rémunération et une absence de large gestion de carrière.
MG : Il y a 2 tendances que je vois dans mon cabinet. Tout d’abord, une tendance au jeunisme avec l’entreprenariat social qui attire des diplômes de grandes écoles ; ensuite, une tendance concernant les seniors de plus de 50 ans qui disent qu’ils vont terminer leur carrière dans l’ESS. Que pensez vous de ces 2 phénomènes ?
PPL : Pour les seniors, je ne suis pas sûr que ce soit une vraie solution. Je vois que les seniors qui s’engagent le font en bénévolat. La priorité, c’est l’emploi des jeunes. Dans notre société, Il faut redonner du sens intergénérationnel. Ceux qui ont vécu avec une prospérité avec un bien-être matériel, civique et social dans les années 60 70 et 80 se doivent d’un effort envers les plus jeunes. De leur côté, les jeunes doivent se poser une question intelligente : Qu’est-ce que je fais de ma vie ? Non, dans ma vie ? Et cela relève d’une responsabilité morale. Il y a un élan, il est vrai, venant de ces jeunes qui sont éduqués, connectés au monde, plus souples et plus nuancés. Ils considèrent que la richesse n’est pas que matérielle mais spirituelle et relationnelle. Et c’est dans ce secteur, on peut penser, qu’on a le plus cet équilibre entre les richesses spirituelles, relationnelles et matérielles.
MG : Y a-t-il une différence de motivation entre salariés et bénévoles dans ce type de secteur ?
PPL : Les bénévoles sont des militants plus que passionnés. Dans les associations traitant des problématiques de santé, les bénévoles sont dans 90% du temps des familles de malades. C’est le cas du Téléthon par exemple. Il n’y a pas de limite d’engagement chez ces bénévoles. Chez des salariés, même s’ils sont fiers d’appartenir à une entreprise « Charitable », il y a un investissement plus fonctionnaliste. Il y une deuxième différence concernant les compétences. En tant que salarié, si vous êtes chargés de la comptabilité ou du développement commercial, on exige de vous des résultats. On a plus d’exigence en terme de performance envers les salariés qu’envers les bénévoles. Cela pose une difficulté dans le cas de bénévoles non compétents et passionnés, il est difficile de les manager.
MG : Ce secteur est en pleine mutation. Sous quelle influence et vers quel futur le voyez-vous évoluez ?
PPL : Le futur est la convergence avec le modèle marchand. L’entreprise Sociale et Solidaire se professionnalise. Et l’entreprise s’ouvre à des facteurs non financiers. On parle par exemple, de l’économie positive qui intègre dans les modes de management beaucoup de social, d’humanité et de relationnelle. On constate cela à la lumière des propos de Tim Cook chez Apple qui dit « Nous faisons des choses pour d’autres choses que pour le profit, nous le faisons car nous pensons que c’est bien et juste ». Apple a une capitalisation qui représente le 1/3 du PNB de la France et qui à ce rythme, sera de la taille de la France d’ici 2020. Et pourtant, le patron d’Apple dit cela tandis que nous gardons de notre côté beaucoup de conservatisme.
MG : Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui veut continuer sa carrière dans ce secteur ?
PPL : Je lui dirai que sa cible corresponde à ce qu’il entend par « faire sens ». Aussi, je lui conseillerai de ne pas compter sur les autres pour l’éclairer afin de déterminer son propre choix ; de se sentir concerné affectivement par la cause de l’association. Cela engage ainsi la passion ; et de persévérer dans les difficultés afin de ne pas renoncer devant les obstacles.
https://www.group3c.net/qui-sommes-nous/notre-equipe/
Interview de Philippe Peuch-Lestrade sur le social business
16 juillet 2015
|In Outplacement